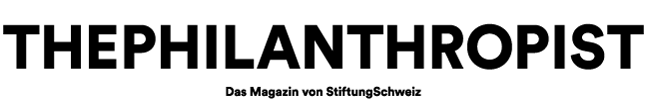Toujours plus grandes, mais toujours moins nombreuses: l’évolution des exploitations agricoles en Suisse va dans une seule direction et toujours plus loin. L’Office fédéral de la statistique a recensé 48 344 exploitations en 2022. Ce chiffre connaît un recul depuis plusieurs décennies. En 1985, la Suisse comptait encore 98 759 exploitations agricoles. Dans un même temps, la surface cultivée par chacune d’entre elles est allée dans la direction opposée. Elle a plus que doublé, atteignant ainsi 21,6 hectares en moyenne. Les exploitations avec une surface de plus de 30 hectares ont nettement augmenté sur cette même période, passant de près de 4000 à 11 300. À l’inverse, il n’existe plus que 7000 exploitations cultivant cinq hectares ou moins alors qu’on en recensait encore plus de 32 000 en 1985. Une évolution à laquelle s’oppose l’association des petits paysans. Cette organisation d’utilité publique regroupant paysans et consommateurs s’engage en faveur des petites exploitations agricoles de Suisse.
Ce faisant, elle vise à préserver la diversité. À tous les égards. «En soi, les petites exploitations ne sont pas plus durables et les grandes ne sont pas moins diverses», affirme Patricia Mariani, co-directrice. «Mais la diversité des exploitations est une valeur importante qu’il convient de préserver.» En effet, chaque ferme est unique et se fixe des priorités différentes. En revanche, une zone qui compte principalement de grandes exploitations ressemble à une agriculture industrielle et perd donc en singularité.

Diversité variétale

La diversité des exploitations est aussi un critère important pour Béla Bartha, directeur général de Pro Specie Rara (PSR). La fondation s’engage en faveur de la préservation des variétés traditionnelles. Afin que l’on puisse trouver de la diversité dans les variétés proposées, Béla Bartha remonte à une étape ultérieure, avant que celles-ci ne soient cultivées dans les fermes. «Nous avons tout d’abord besoin de diversité chez les producteurs de semence», déclare-t-il.
Il explique qu’il n’existe aujourd’hui plus que quelques grands semenciers. Les inciter à proposer des semences pour des variétés traditionnelles est difficile. Ce qui rend le travail encore plus compliqué, c’est que jusqu’en 2010, seules les variétés inscrites sur la liste officielle de la Confédération pouvaient être cultivées et commercialisées à grande échelle.
Fortement réglementé
«Il n’existe aucun autre domaine qui est aussi strictement réglementé que celui des semences», déclare Béla Bartha qui ajoute: «Avant même de pouvoir évoquer l’éventualité d’une plus grande diversité dans les champs, nous avons aussi besoin de semenciers prêts à produire les quantités nécessaires et les conditions-cadres qui nous autorisent à cultiver les variétés en question.» La mise en place d’une plus grande offre variétale est donc pour lui une mission de société. Aujourd’hui, outre les systèmes de culture conventionnels, il existe aussi des alternatives mieux adaptées à l’intégration d’une plus grande diversité de variétés dans la production. «Il faudrait simplement pouvoir se procurer des semences de diverses variétés et de bonne qualité.» Pour que la production de semences d’une variété soit rentable, il en faut une certaine quantité. PSR y parvient en proposant différents produits de la même variété sur plusieurs canaux. De PSR, on ne trouve pas que les tomates dans les rayons de Coop. Elle propose les mêmes variétés de tomates en tant que jeunes plants sur son marché ou en tant que graines dans les magasins de bricolage. Le fait que les anciennes variétés soient disponibles dans la grande distribution n’est pas une évidence et peut sembler discutable de prime abord. «Pour l’Europe, cette coopération entre un grand distributeur et une organisation de préservation est singulière», déclare Béla Bartha. Il considère cela comme extrêmement important pour les préoccupations de la fondation. Il ajoute: «On peut mourir en beauté ou alors s’asseoir autour de la table et entamer le dialogue.» PSR souhaite rendre la diversité accessible à un vaste public. Pour ce faire, elle utilise chaque canal qui s’offre à elle. La seule manière de susciter la demande, c’est de veiller à ce que les individus soient en contact avec la diversité, lors de leurs courses quotidiennes par exemple. Et celle-ci contribue à la rentabilité d’une variété traditionnelle. Malgré tous les efforts, il reste une lacune difficile à combler sur le plan financier le long de la chaîne de valeur: pour préserver les variétés, PSR travaille généralement avec de petites quantités de semences. «Lorsqu’un agriculteur se montre intéressé par une variété, nous devons tout d’abord multiplier la semence», déclare Béla Bartha. Il s’agit là d’un processus qui peut prendre quatre à cinq ans pour atteindre la quantité nécessaire. «Cela peut asphyxier la demande», déclare-t-il. C’est pourquoi PSR devrait déjà préalablement produire une quantité adaptée pour les variétés prometteuses et les garder à disposition des semenciers éventuellement intéressés afin qu’ils puissent immédiatement se lancer dans la multiplication pour le commerce. Béla Bartha fait en outre remarquer que la production de grandes quantités de semences contribue aussi à une meilleure préservation de la variété. Cet investissement préliminaire ne peut être refinancé par le commerce, aussi, Pro Specia Rara dépend là aussi en partie du financement de fondations.
5600 variétés
PSR a assuré par son engagement la préservation de plus de 5600 espèces traditionnelles. Pour ce faire, elle s’appuie sur son réseau de plus de 500 gardiens de variétés, agriculteurs et producteurs de semences bénévoles. Ils assurent la préservation «on farm» (dans leurs fermes ou leurs jardins). «Nous cultivons chaque année environ un tiers de toutes les variétés», déclare Béla Bartha. «Tous les ans, notre réseau multiplie ces variétés, renouvelle ainsi les semences et en renvoie une partie à la centrale à Bâle.» Grâce à la culture répétée, les espèces ont l’opportunité de s’adapter à l’environnement en constante mutation. «Les espèces s’adaptent même aux préférences des différents agriculteurs», déclare-t-il, «car chaque personne qui s’engage pour nous, qu’elle ait un grand champ ou un jardin, sélectionne les plantes pour lesquelles elle va obtenir des graines plus tard selon certaines caractéristiques qu’elle aimerait trouver.» Ces attentes individuelles (caractéristiques variétales) ainsi que les méthodes de culture vont au final déterminer l’aspect et les propriétés de la variété. Le climat d’une région est aussi déterminant. Au cours d’une année sèche, les propriétés peuvent se développer différemment de lors d’une année humide. Ainsi, la variété est en mutation constante, même si le type variétal doit être préservé autant que possible par le biais d’une sélection constante. La préservation «on farm» est ainsi quelque chose de dynamique. «Nous voulons aussi préserver cette dynamique et cette capacité d’adaptation dans nos populations», déclare Béla Bartha. C’est pourquoi il est tout aussi important pour la fondation que de nombreuses personnes participent au travail de préservation. PSR ne procède ici pas comme une banque génétique traditionnelle qui multiplie aussi les semences, mais qui les congèle par la suite et les ressort tous les 50 ans afin d’éviter l’adaptation constante à l’environnement.

Préserver les connaissances anciennes.
Une perspective réjouissante
Pour qu’il y ait une diversité chez les producteurs, il faut une diversité chez les acheteurs. Parmi les petites et moyennes exploitations agricoles, beaucoup vendent leurs produits directement aux consommateurs, mais aussi au commerce local comme les petites fromageries de village, les boucheries ou les restaurants. Certaines sont même organisées en coopératives. Cela permet d’échapper quelque peu à la pression générale exercée sur les prix par la grande distribution. Au cours des dernières années, la vente directe a gagné en importance. Tandis qu’en 2010, 7000 exploitations vendaient leurs produits directement aux consommateurs, on en comptait 12 600 en 2020. Patricia Mariani est convaincue que cela constitue une perspective économique réjouissante pour les petites exploitations. «Lorsqu’il est question de petites quantités, un magasin de ferme peut être un canal idéal», déclare-t-elle. «Une grande ferme dispose de quantités nettement plus importantes. Elle a besoin d’une plus grande fréquentation si elle souhaite tout écouler directement.» Pendant la pandémie notamment, les magasins de ferme ont joui d’une popularité accrue auprès des consommateurs. Mais l’évolution montre aussi les limites du canal. Patricia Mariani fait remarquer qu’il y a parfois un gouffre entre les désirs et la réalité. En effet, après la pandémie, la demande a de nouveau baissé. Les raisons peuvent être diverses. Se rendre dans une ferme peut être compliqué et chronophage. Néanmoins, les canaux alternatifs offrent des opportunités. Les offres d’abonnement, auxquelles on peut souscrire sur Internet, permettent aux agriculteurs de vendre directement leurs produits aux consommateurs, et ce, de manière régulière. Avec des offres de restauration, les exploitations agricoles peuvent en outre vendre leurs marchandises directement à la ferme.
Contact direct avec la clientèle
Qui dit nouveaux canaux de vente, dit nouvelles possibilités et nouvelles missions pour les agriculteurs. Patricia Mariani précise que l’agriculteur doit aussi être habile dans l’art de gérer le contact direct avec le client. «Mais si c’est le cas, il a un véritable avantage», explique-t-elle. «Il peut échanger directement avec ses consommateurs.» Ceux-ci peuvent lui faire part de leurs retours ou de leur appréciation. Et il peut en apprendre davantage sur leurs préférences et leurs souhaits – ou aussi sur ce qu’ils n’aiment pas. Qui plus est, l’agriculture et la production alimentaire deviennent tangibles pour eux. Ce ne sont plus des termes théoriques. C’est un facteur déterminant. Pour que les consommateurs réclament de la diversité, ils doivent aussi la côtoyer. «Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de transformer les habitudes de consommation», déclare Béla Bartha en citant l’exemple de l’assortiment de tomates dans les supermarchés. Il y a 20 ans, les tomates proposées étaient toutes rouges et de même forme. Désormais, on trouve tous les jours dans les rayons des tomates-cerises, des tomates charnues ou des variétés jaunes. Même les cœurs de bœuf n’ont aujourd’hui plus rien d’exotique. «Pour souligner à quel point il est difficile de sortir de sa zone de confort, il existe une expression allemande qui dit que ‹le paysan ne mange pas ce qu’il ne connaît pas›», déclare Béla Bartha. «C’est aussi souvent le cas chez les consommateurs qui tendent à être plutôt conservateurs lorsqu’il est question d’alimentation. Proposer un ‹nouvel› inconnu, sous la forme de variétés traditionnelles et souvent oubliées, demande un gros travail de communication et de persuasion sur autant de canaux que possible.»
Une base de connaissances
C’est précisément pour ces connaissances que Horst Lichtner, directeur de la fondation KEDA (patrimonie culinaire des Alpes) s’engage. Il gère le Culinarium Alpinum qui a aujourd’hui investi l’ancien monastère de Stans. La fondation a derrière elle une histoire mouvementée. Créée en 2016, elle a déjà connu quelques changements. Et la pandémie de coronavirus a rendu son travail encore plus compliqué. Des années durant, différentes équipes ont tenté de trouver une structure fonctionnelle.

«Je suis le troisième directeur en trois ans», déclare Horst Lichtner. «J’ai pour mission de faire vivre la gastronomie alpine.» Il est convaincu que les choses avancent lentement mais sûrement vers une situation stable. Mais la tâche reste complexe. «Nous sommes en fait une start-up», affirme-t-il. De nombreux projets sont en cours. Le Culinarium Alpinum a déposé une candidature pour être inscrit au patrimoine mondial. «Le Culinarium Alpinum, c’est une histoire très compliquée. Nous avons construit un restaurant dans le monastère, vivons la cuisine locale et cherchons à en faire un pavillon de la culture gastronomie alpine», raconte Horst Lichtner. En outre, l’équipe de Culinarium Alpinum est en train de développer une base de connaissances. Mais le projet n’en est qu’à ses débuts. Le directeur se montre néanmoins enthousiaste. «C’est une excellente initiative», se réjouit-il, «nous cultivons le savoir de la gastronomie régionale, nous avons pour ainsi dire un paysage comestible.» Ces connaissances portent sur les anciennes variétés, mais pas uniquement. Le savoir autour des méthodes de culture ou de la préparation telle qu’on le trouve dans les recettes traditionnelles est tout aussi précieux. Mais le dénicher et faire en sorte qu’il soit à l’épreuve du temps est une tâche complexe. «Beaucoup de ces connaissances ont été transmises quelque part, et potentiellement aussi uniquement à l’oral. C’est précisément ce que nous souhaitons préserver», déclare Horst Lichtner. Cela n’est possible que par le biais de nombreux échanges avec des personnes susceptibles de détenir ces savoirs.
Le potentiel de faire du neuf avec du vieux
Le Culinarium Alpinum souhaite rendre ce savoir accessible au public. «Notre objectif doit être de susciter la curiosité chez les individus», déclare Horst Lichtner. Il y a du chemin à parcourir selon lui, car les gens manquent encore de curiosité. Il y a de nombreuses histoires qui n’attendent que d’être découvertes et racontées. Le potentiel est énorme. Mais il faut parvenir à modifier les comportements afin que les individus s’enthousiasment pour ce savoir. «Réussir à changer les comportements fait partie des choses les plus difficiles», déclare-t-il, «mais nous devons avoir le courage d’essayer». Pour lui, sans transformation, rien n’est possible. Au final, l’alimentation est une partie majeure de la vie. Chaque jour, nous consacrons des heures à ce que nous mangeons et buvons. Il est question de nourriture et de plaisir, une expérience riche en émotions. «Nous pouvons appuyer sur ces émotions pour aller chercher les individus, les enthousiasmer, les faire goûter et les faire sentir», déclare Horst Lichtner. Il plaide pour que nous renoncions à cette mentalité de supermarché qui veut que l’on trouve des fraises en rayon tous les jours, quelle que soit la saison. D’après lui, cela a été considéré comme un progrès culturel à une époque. «Nous devons changer notre manière de penser. Nous devons faire partie intégrante de ce changement», déclare-t-il. «C’est la seule manière d’assurer le futur de notre planète.» Pour Béla Bartha, il est possible de trouver les solutions de demain en se penchant sur les variétés traditionnelles du passé. Il explique que certaines d’entre elles possèdent des propriétés qui les rendent même mieux adaptées aux nouvelles conditions environnementales. Il pense par exemple à des variétés du Valais ou des Grisons qui sont habituées à des étés secs et continentaux. D’anciennes variétés de choux qui développent des feuilles basales tombant directement sur le sol empêchant ainsi la pousse de mauvaises herbes tout en assurant un microclimat humide en dessous qui les protègent de la sécheresse, ou des céréales à grande racine en mesure d’absorber beaucoup d’eau et de nutriments en peu de temps. Et ce sont précisément ces propriétés qui ont souvent été éradiquées au fil du temps pour des raisons d’efficience puis remplacées par l’irrigation et les engrais artificiels. «Prendre soin de ces anciennes variétés est donc pertinent. Elles recèlent un immense potentiel à même de garantir notre sécurité alimentaire aujourd’hui comme demain.»