Les données renferment un immense potentiel, même pour le secteur tertiaire. C’est un fait souvent méconnu ou insuffisamment exploité en raison d’un manque de ressources. Dans un même temps, le secteur pourrait endosser une plus grande responsabilité.
«Dans le domaine de la philanthropie, l’étude d’outils numériques peut être un moyen d’impliquer les jeunes ainsi que d’autres voix dans l’attribution de subventions», déclare Stefan Germann, CEO de la fondation Botnar. «Les outils de participation numériques et de crowdsourcing peuvent permettre aux philanthropes de rendre le processus d’octroi de subventions plus innovant et intégratif.» Les délibérations sur les subventions et les investissements peuvent ainsi être votées par un groupe cible plus large.

Des cercles traditionnellement fermés sont ainsi intégrés aux processus de consultation. «En recourant à une approche Digital First, nous pouvons créer un moyen facilement négociable de tenir compte d’une grande variété d’idées du monde entier», continue Stefan Germann. Afin de concrétiser ses projets en gardant ses objectifs à l’esprit, la fondation Botnar utilise aujourd’hui déjà de manière conséquente les technologies numériques et l’intelligence artificielle (IA). Chercher à améliorer le bien-être des jeunes est l’une de ses missions principales. Stefan Germann est convaincu que l’IA et les technologies numériques sont indispensables pour y parvenir. «Nous croyons au pouvoir de transformation de l’IA afin de surmonter des défis sanitaires, sociaux et économiques au niveau municipal, mais aussi national.» Mais il a conscience que ces perspectives s’accompagnent également de responsabilité. La protection des droits est certes un devoir qui incombe aux États, il est néanmoins crucial que les jeunes comprennent leurs droits numériques. «De cette manière, ils peuvent faire pression sur les organisations – des gouvernements au secteur privé – afin que les outils numériques de collecte de données personnelles qu’ils développent et utilisent le soient de manière aussi juste que responsable. La fondation Botnar accorde aussi une grande importance aux droits des données. Cela englobe plus que la simple protection des informations et la vie privée, la liberté d’expression ou la modération de contenus. «Nous nous concentrons sur tous les aspects des droits humains, y compris celui du droit souvent négligé à l’accès à Internet et à la technologie», déclare Stefan Germann. Pour illustrer l’engagement de la fondation Botnar en la matière, il prend l’exemple de «RIGHTS Click». Grâce à ce projet, qui est le fruit d’une collaboration avec Amnesty International, la fondation souhaite faire entendre la voix des jeunes et leur donner les moyens de s’engager en faveur d’un écosystème numérique respectant leurs droits et leur bien-être. Ensemble, ils souhaitent mieux comprendre les défis que le monde numérique posera à la jeunesse. Pour ce faire, ils ont mis au point une enquête dont les conclusions peuvent bénéficier au développement politique du domaine. Ils ont déjà rassemblé les réponses de 45 pays. «Ceci est incroyablement utile pour obtenir une vision globale des problèmes auxquels sont confrontés les jeunes», assure Stefan Germann. Dans le domaine de la santé aussi, la fondation Botnar subventionne des projets pilotés par des données. La santé psychique des jeunes est un enjeu de taille à l’heure actuelle. Aujourd’hui, il n’y a que très peu de données sur le sujet dans les pays à faible et moyen revenu. Afin d’y remédier, la fondation Botnar a lancé en 2022 l’initiative internationale «Being» en collaboration avec Grand Challenges Canada (GCC) et United for Global Mental Health. Celle-ci soutient la recherche et les approches innovantes visant à améliorer le bien-être psychique des jeunes dans les pays à faible et moyen revenu tels que la Roumanie, la Tanzanie ou la Sierra Leone.
Un intérêt étonnamment limité

Ce manque de donnée peut avoir diverses raisons. En Suisse, le secteur de l’utilité publique en est victime. De manière similaire, la disponibilité des informations est également limitée. Pour Georg von Schnurbein, directeur du Centre d’études de la philanthropie en Suisse (CEPS) de l’Université de Bâle, cela est dû à l’absence d’un principe de publication obligatoire. Quelques organisations publient certes sur des thèmes précis: comme la fondation Zewo avec Swissfundraising, qui publie des chiffres sur le secteur des dons, la Société suisse d’utilité publique (SSUP), l’Office fédéral de la statistique ou le CEPS.
Il manque cependant un aperçu de l’ensemble des OSBL, de leur développement économique ou du nombre de membres, etc. «Tout ce que l’on a jusqu’à aujourd’hui, ce sont des travaux fragmentaires», déclare Georg von Schnurbein. D’autres relevés, comme le projet John Hopkins, le plus vaste portant sur des données du secteur tertiaire du monde entier, ne sont pas poursuivis en continu. Ainsi, le secteur n’a que des moyens limités d’apparaître de manière homogène auprès du grand public. Son évolution n’est donc que partiellement saisissable. Qui plus est, le besoin ne se limite pas à la collecte de données. «Il est tout aussi important que les données soient facilement accessibles pour le public», déclare Georg von Schnurbein. «L’État devrait agir en ce sens. Mais la politique nationale ne fait étonnamment preuve que d’un intérêt limité lorsqu’il est question d’en savoir plus sur le secteur des OSBL», observe-t-il. Grâce à NPO Data Lab, le CEPS a rendu public en 2021 une base de données spécifique au secteur philanthropique. Le Lab regroupe pour l’instant deux bases de données. L’une contient des informations agrégées sur les fondations d’utilité publique et les conseils de fondation de Suisse. L’autre comprend des données financières sur les OSBL suisses qui ont publié leurs comptes annuels conformément au standard Swiss GAAP RCP 21. «C’est surtout l’outil de comparaison permettant de faire un rapprochement entre la situation financière de son organisation et celle d’un OSBL comparable qui rencontre un certain succès», déclare Georg von Schnurbein.
Une tout autre réalité
Les organisations font en partie face au défi de n’avoir pratiquement aucune donnée. «Bien évidemment, je préférerais obtenir des données structurées», déclare Stefanie Holm, directrice générale de la fondation VISIO-Permacultura. «Mais cela ne correspond pas à la réalité. Nous avons principalement des projets qui ont besoin de soutien.» La fondation est la première à être active dans ce domaine. Elle a pour objectif d’établir dans l’agriculture les connaissances tirées de la permaculture tout en soutenant l’enseignement, la transmission de savoirs et la mise en réseau.

Dans ce contexte, Stefanie Holm pointe deux défis essentiels qui compliquent l’utilisation potentielle de données structurées dans son travail. Il y a premièrement la terminologie: «Toutes les exploitations agricoles n’utilisent pas le terme de permaculture de la même manière», constate-t-elle. «L’emploi est très divers, il n’y a pas de définition claire.» Le terme englobe différentes composantes. C’est à la fois un mouvement social, un système de conception et un ensemble de méthodes agricoles. VISIO-Permacultura n’exige pas non plus une définition exacte avant de s’engager. Elle s’oriente sur ce qui est durable et respectueux de l’environnement. L’utilisabilité statistique est le deuxième défi qui rend difficile une approche pilotée par les données. Environ 200 fermes bénéficient de paiements directs pour leur permaculture. «En raison du chiffre assez faible et des particularités individuelles, aucune base de données ne permettrait de tirer des conclusions statistiques pertinentes.» Et, bien que le travail de terrain, lui aussi subventionné, livre des données, celles-ci ne sont pas obtenues dans des conditions de laboratoire et sont donc exposées à de nombreuses influences comme des étés chauds ou des hivers froids. Aussi, au sujet d’une base de données méthodologique, Stefanie Holm déclare: «Ce serait très sympa. Mais cela relève d’une réalité très éloignée de la nôtre.»
Regrouper les données

De prime abord, il peut être surprenant de constater que pratiquement aucune donnée n’est disponible pour la recherche ou la planification dans le domaine de la mobilité alors que toute personne disposant d’un téléphone portable laisse constamment des pistes de données derrière elle. Afin de créer une bonne base de données pour la mobilité du futur, la coopérative Posmo a été lancée en 2020. Les fondatrices et fondateurs en sont convaincus: afin de protéger l’environnement et répondre aux besoins des villes, nous avons besoin de ces données. Mais aujourd’hui, la recherche sur la mobilité ne se fait qu’avec de petits jeux de données, d’après ce que nous révèle Lea Strohm, l’une des fondatrices.
Ces données existent. Google ou Apple connaissent nos habitudes en matière de mobilité. «Mais nous n’avons aucun accès ni contrôle», ajoute-t-elle. «Ce sont aussi des données extrêmement sensibles.» Pour Lea Strohm, seule une toute petite partie de la société s’intéresse réellement à ces données et à leur sécurité. La plupart des gens ignorent qu’il est essentiel de les protéger. Elles ont l’impression de ne rien avoir à cacher. Aussi, la gouvernance des données est ce qui a motivé la création de la coopérative en second lieu. Posmo souhaite développer un modèle permettant de mettre ces données à disposition pour la recherche et la planification tout en gardant le contrôle. Il n’est donc ici pas question de la protection des données au sens juridiquement ancré. «Comment moi, Lea Strohm, je me déplace en tant qu’individu, ça ne m’intéresse que très peu», déclare-t-elle Ce qui est intéressant, c’est d’agréger les données de plusieurs personnes et d’en tirer des enseignements. C’est à cette fin que Posmo souhaite développer un modèle qui permet de mettre en commun les données individuelles afin qu’elles puissent être utilisées dans les approches applicatives. La forme juridique a aussi été choisie avec l’idée de pools de données et d’intérêt public en tête. En effet, toutes les personnes qui entrent dans la coopérative «paient» leur adhésion avec leurs données. Cela a une raison simple: «En tant que membre, tout le monde prend part aux délibérations autour de l’utilisation des données», déclare Lea Strohm de Posmo avant d’ajouter «mais chacun doit aussi littéralement donner de sa personne – prendre un risque personnel, apporter ses propres données. Pour participer, il faut contribuer.»
Utile à toute la société
D’après ses statuts, la coopérative souhaite gérer «une plateforme informatique sécurisée servant l’intérêt général» et la mettre à disposition. Lea Strohm insiste bien sur le fait que celle-ci doit servir à toute la société. «Nous ne voulons pas que nos données soient principalement utilisées à des fins commerciales.» Mais ils ne visent pas non plus une approche open data. Cela semble contredire le principe selon lequel celui qui dispose des données et décide doit lui-même fournir des données. Néanmoins, ils travaillent encore à définir plus précisément l’intérêt général. Outre le développement technologique, la coopérative se penche majoritairement en ce moment sur les moyens qui existent pour assurer la transparence vis-à-vis de celles et ceux qui fournissent les données. Lea Strohm voit Posmo comme un courtier en données. Les fournisseuses et fournisseurs doivent être en mesure de voir pour quels projets les données sont utilisées et de s’informer sur ceux-ci. Et les différents processus doivent être transparents. «Nous avons un conseil d’éthique», déclare-t-elle. Tandis que l’administration de l’organe directeur est axée sur la croissance, le conseil d’éthique doit donner sa bénédiction à chaque utilisation des données. Il valide les demandes selon qu’elles sont ou non conformes à l’objet. La décision du conseil est dans tous les cas contraignante. Il prend ses distances et garantit l’équilibre des pouvoirs. Les critères de la décision doivent également être transparents.
Accès libre au savoir
Sur Wikipedia aussi, la transparence est un élément central. Les personnes ayant rédigé, commenté ou modifié un article sont visibles dans l’historique des versions. L’encyclopédie en ligne est basée sur le travail de bénévoles. L’un des principes de base est d’être non commercial et donc indépendant. «La communauté des Wikipédiens veille elle-même au bon respect de ses directives», déclare Kerstin Sonnekalb, porte-parole de Wikimedia CH.

Cette association d’utilité publique soutient le travail des auteurs et autrices bénévoles, fournit des conseils ou ouvre des portes à d’autres recherches. Wikimedia CH est reconnue comme un «chapter» (filiale) officiel de la fondation Wikipedia qui gère l’encyclopédie. Les fondateurs et fondatrices de Wikimedia CH ont perçu en 2006 la nécessité de pouvoir compter sur une organisation et un porte-parole pour s’occuper en Suisse des préoccupations du mouvement Wikimedia – soit des Wikipédiens et Wikipédiennes dans leur ensemble – et défendre leurs intérêts. Ceci est ainsi sa mission principale. Kerstin Sonnekalb précise: «Notre association n’influence en aucun cas les contenus de Wikipedia.» Elle répond toutefois à une préoccupation majeure: la lutte contre les fausses informations, ou Fake News. «En s’inscrivant dans ce mouvement qui s’engage en faveur d’un accès libre à un savoir objectif, Wikimedia CH travaille aussi d’arrache-pied pour que Wikipedia et ses projets connexes restent une source d’information factuelle et fiable sur les sujets critiques et veille à lutter contre les fausses informations en ligne», déclare-t-elle. Ceci est aussi l’un des objectifs définis dans le processus stratégique du mouvement pour 2030. Les sujets extrêmement polarisants, comme l’article sur la pandémie de Covid-19 qui, dans sa version anglaise, comptait jusqu’en janvier 2023 3449 contributeurs et contributrices ayant apporté des modifications plus de 25 670 fois, font l’objet d’une surveillance accrue par les administrateurs. Cette étape supplémentaire contribue à ce que l’article contienne des informations correctes et factuelles.
Vrai ou faux
Wikimedia CH utilise de plus en plus souvent des événements actuels afin de souligner l’importance d’informations libres et impartiales pour la participation au processus démocratique. Cette année, l’association mise sur le 175e anniversaire de la Constitution fédérale suisse, «car un processus de formation d’opinion démocratique s’appuie sur des informations libres d’accès», déclare Kerstin Sonnekalb. Cela partage aussi un lien avec un autre objectif central de l’association: sensibiliser et éduquer les individus de tout âge, peu importe leur niveau d’étude, aux informations en ligne. L’engagement contre les Fake News concerne aussi la manière d’appréhender les sujets controversés. Les auteurs et autrices n’ont pas pour mission de décider de ce qui est vrai ou non. Les controverses devraient avant tout être présentées comme telles. C’est la raison pour laquelle il faut avant tout des indications fiables sur les sources pour qu’une information ait sa place sur Wikipedia. . «La qualité des sources est un critère décisif. Ainsi, les déclarations scientifiquement étayées ont beaucoup de poids», souligne Kerstin Sonnekalb. Même si Internet regorge de savoirs et que l’intelligence artificielle continue de révolutionner les processus de recherche, la quantité ne dit rien de la qualité. «Même les meilleures IA sont entièrement tributaires des données sur lesquelles elles s’appuient», déclare Kerstin Sonnekalb. Cela vaut aussi pour ChatGPT, la nouvelle intelligence artificielle qui a enflammé Internet en janvier. «La curation par un humain ne saurait être remplacée. Qu’il s’agisse d’informations tirées d’articles Wikipedia ou de méta-données issues de Wikidate – l’univers Wiki restera une base de savoirs bienvenue pour les moteurs de recherche en ligne», en est-elle convaincue.
Indépendante et digne de confiance
Bien avant qu’une intelligence artificielle disponible sur Internet ne puisse rédiger des travaux universitaires entiers, une fondation a été créée en 1987 en Suisse en vue de favoriser la numérisation des hautes écoles. Celle-ci devait permettre la mise en réseau des institutions au sein même de la Suisse et avec l’étranger. Et aujourd’hui encore, Switch continue ce travail. «Pour l’enseignement, la recherche et l’innovation, c’est un partenaire idéal, indépendant et digne de confiance. En outre, la forme juridique de la fondation reste optimale», déclare son porte-parole Roland Eugster.

Ce qui a aidé, c’est que l’objet de la fondation a été rédigé de manière très large à l’époque. Cela a laissé beaucoup de place aux évolutions ultérieures. L’indépendance de la fondation est aussi utile pour deux autres missions: plus de deux millions et demi de noms de domaine «.ch» sont enregistrés chez Switch. «La Confédération réglemente l’octroi des noms de domaine avec des lois et des ordonnances et offre ainsi un cadre juridique solide pour cette mission de confiance», déclare-t-il. L’Office fédéral de la communication a délégué la gestion des domaines en «.ch» à Switch. Pour les tâches de numérisation de cette importance, la sécurité est aussi une priorité constante. Une autre mission que Switch prend très au sérieux. Roland Eugster précise: «Notre Computer Emergency Response Team SWITCH-CERT est un centre de compétence indépendant et leader en matière de sécurité de l’information.» C’est l’un des deux CERT nationaux qui aide les hautes écoles suisses, les registraires «.ch» et les domaines correspondants ainsi que les secteurs des banques, de l’industrie, de la logistique et de l’énergie à lutter contre les cyber-menaces. Dans un tel contexte, Roland Eugster est aussi convaincu que l’absence de but lucratif de la fondation est précisément ce qu’il faut. Et cette mission s’inscrit dans le temps. «Les hautes écoles ont besoin de solutions numériques pour toute une série d’applications», déclare-t-il. Celles que proposent les entreprises commerciales sont toutes standardisées. Si cela suffit amplement pour certaines utilisations, il est impératif de recourir à des solutions sur mesure dès lors que les applications sont spécifiques et que les données nécessitent une protection renforcée. «Étant donné que nous travaillons de manière aussi étroite avec le monde de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation depuis 35 ans, nous connaissons de manière très précise ses besoins parfois extrêmement particuliers», déclare le porte-parole. «Cela nous permet d’estimer pour eux la pertinence des innovations technologiques et de leur montrer comment les utiliser de manière optimale.»
Pertinence pour le secteur
Pour les OSBL aussi, le progrès technologique est de plus en plus important. Il est judicieux que le secteur se penche activement sur la question et l’exploite pour lui-même, ses objectifs et ses destinataires. «Utilisées de manière responsable, l’IA et l’innovation numérique ont le potentiel d’améliorer durablement la vie de nombreuses personnes à travers le monde. Les nouvelles technologies et le pouvoir des données pourraient offrir de nouveaux moyens de surmonter les défis sanitaires, sociaux et économiques persistants avec une ampleur et une accessibilité jamais vues par le passé», déclare Stefan Germann. Il y voit un potentiel énorme à condition que la société parvienne à utiliser ces instruments de manière intelligente: «Nous avons ainsi une chance de créer un système juste et sécurisé pour les générations futures.» Il prend l’exemple de l’initiative Transform Health. Il s’agit d’une coalition qui s’engage pour une transformation numérique équitable des systèmes de la santé. Celle-ci plaide en faveur d’un accès libre à des technologies numériques pionnières à même d’améliorer la santé. Avec cela, il est aussi nécessaire de renforcer la gouvernance des données de santé. «La numérisation est l’avenir de nombreux pays et secteurs. Il est crucial que nous l’acceptions et que nous garantissions un accès équitable à ces services. Les données sont un instrument important à même de transformer nos vies», déclare Stefan Germann.
Collecte de données
Pour Georg von Schnurbein, bien gérer et protéger les données tout en garantissant leur transparence est une obligation qui incombe aux OSBL. «Un OSBL exonéré d’impôts servant l’intérêt général ou profitant d’avantages fiscaux en poursuivant un idéal n’est pas une affaire strictement privée. Il doit accepter une certaine forme de transparence publique». Pour lui, le secteur a tout intérêt à exploiter ces données, en respectant certaines règles, bien entendu. En effet, collecter les données, les agréger et les rendre disponibles n’est pas une mauvaise chose en soi et aiderait à mieux comprendre. «Cela relève toujours de la négligence quand une organisation en sait moins sur elle-même que d’autres», déclare-t-il. Cela vaut aussi pour le secteur des organismes sans but lucratif dans son ensemble. Ainsi, il estime que lorsque des sociétés privées ou l’État collectent les données par le biais de ce secteur, les OSBL abandonnent une partie de leurs capacités d’influence. Dans un même temps, il a clairement conscience qu’un OSBL seul ne peut rien faire avec ses propres données. La valeur provient uniquement du regroupement. Il est toutefois convaincu que les OSBL pourraient constituer un certain pouvoir de marché avec leurs données. Georg von Schnurbein déclare ainsi: «Si des fondations devenaient désormais copropriétaires sur une plateforme comme StiftungSchweiz, cela constituerait une bonne étape pour prendre part aux discussions autour de l’utilisation future des données.»

Image IA sur le thème du CEPS Mots-clés: trop peu de données pour le développement économique. Les données disponibles doivent être rendues accessibles et comparables.

Image IA sur le thème de Visio Permakultura. Mots-clés: agriculture durable et respectueuse de l’environnement. Seulement 200 fermes jusqu’à présent pour la base de données. Les données structurées ne reflètent pas la réalité.

Image IA sur le thème de la coopérative POSMO. Mots-clés: idée d’un pool (de données), données hautement sensibles et à protéger. Gouvernance des données.

Image IA sur le thème de Wikimedia. Mots-clés: contre les fake news, inscrit dans le mouvement qui s’engage en faveur d’un accès libre à un savoir objectif, fiable, basé sur les faits.
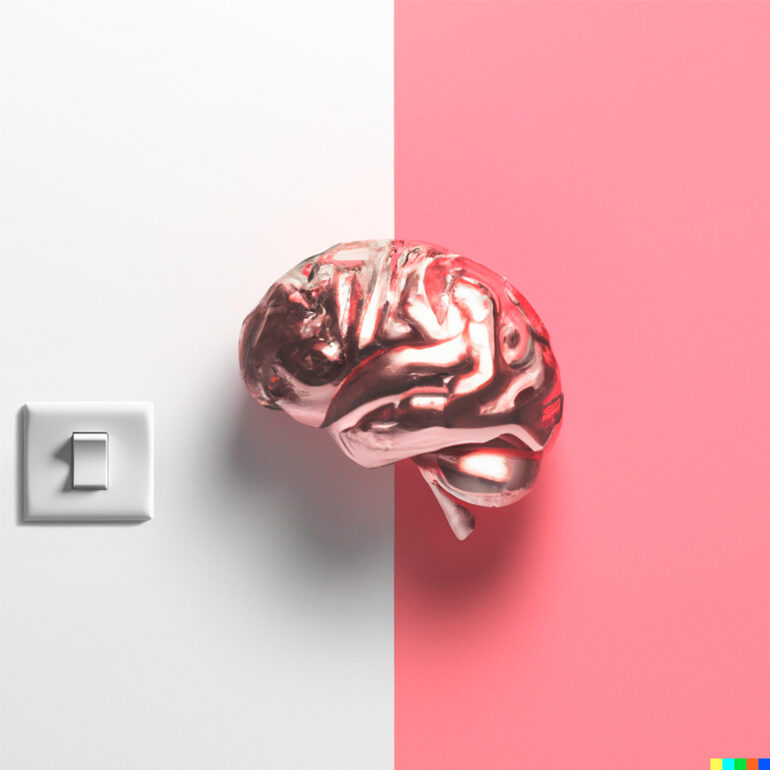
Open AI, généré par DALL‑E sur le thème de de SWITCH. Mots-clés: numérisation des hautes écoles, cerveau, commutateur, sécurité de l’information.
Interprétations pour l’alimentation du logiciel AI: Peter Kruppa


