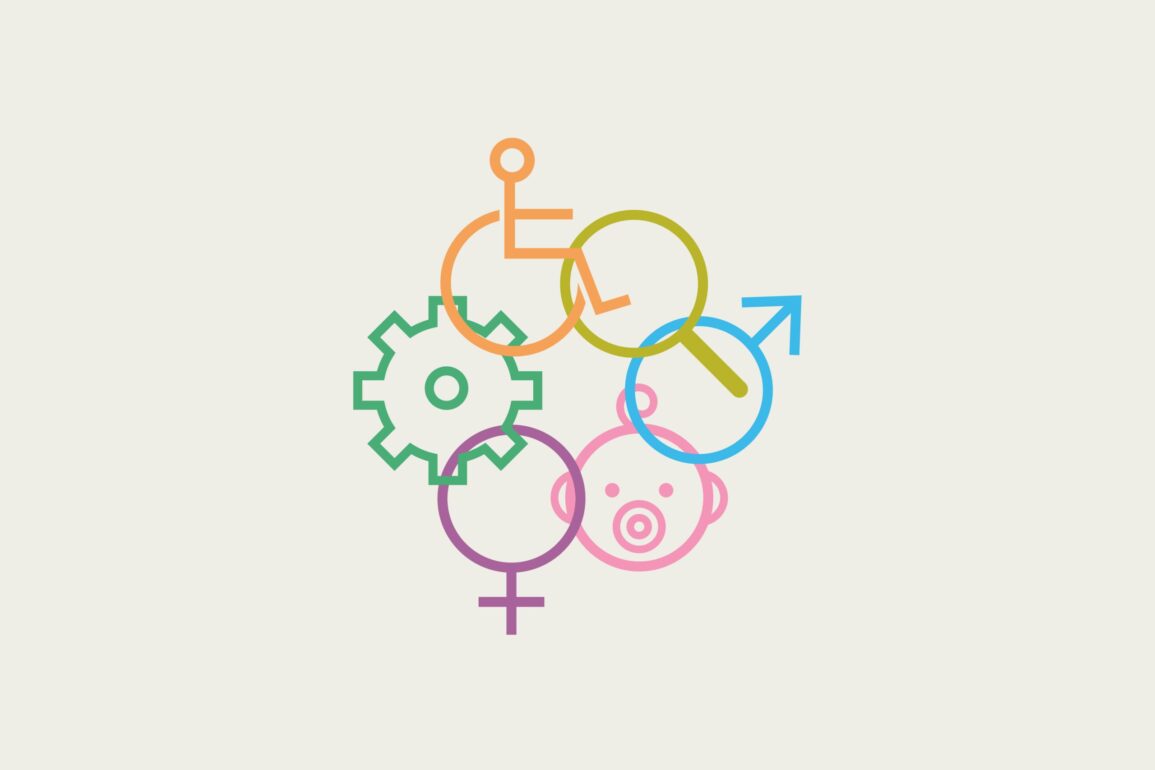La Haute école spécialisée à distance de Suisse (HESD) fait de la recherche, financée entre autres par des fondations, et enseigne. Une étude récente sur les institutions pour adultes en situation de handicap montre de manière exemplaire le fonctionnement de la recherche fondamentale orientée vers l’application à la HESD.
L’idée selon laquelle la recherche fondamentale dans le domaine social serait commercialisable trouve régulièrement ses limites», fait observer Daniel Zöbeli, directeur de l’Institut pour le management et l’innovation. Il n’est pas pertinent pour tout type de recherche de déboucher sur une analyse de rentabilité, comme l’exige par exemple l’agence de promotion d’État Innosuisse.

«C’est précisément la raison pour laquelle la HESD effectue des recherches financées par des fondations», ajoute Daniela Mühlenberg-Schmitz, directrice d’un secteur de recherche et enseignante à la HESD. Elle dirige actuellement une étude consacrée à la saisie et au financement de la prise en charge dans les institutions pour adultes en situation de handicap en Suisse (Erfibel).

La Haute école de travail social d’Olten et le Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) du Tessin couvrent le volet sociopédagogique et la HESD le volet économique. Le contexte de l’étude est le changement de souveraineté financière des institutions pour personnes handicapées, passant de la Confédération aux cantons. Il s’agit notamment de mettre en évidence les incitations inopportunes des modèles de financement habituels et de proposer des solutions pour continuer à assurer la qualité de la prise en charge malgré des finances publiques de plus en plus limitées.
Maniement de la variable d’ajustement financière
Le projet Erfibel se place dans un contexte social. «Il ne s’agit pas d’une implacable analyse de rentabilité», souligne Daniela Mühlenberg-Schmitz, mais bien davantage d’apprendre ce que le maniement de la variable d’ajustement financière signifie pour les personnes souffrant de handicap. «Un besoin de clarification se dessine entre les cantons et les institutions», souligne la chercheuse. «Les cantons passent d’une garantie de déficit à des budgets forfaitaires. Pour le financement, ils misent sur les besoins d’assistance particuliers faisant appel à une grille de prestations», explique-t-elle. L’analyse montre que les cantons estiment l’autonomie de décision des institutions comme étant bien supérieure à ce que pensent ces dernières. Les institutions sont en outre plutôt satisfaites de la mise en œuvre et de l’introduction des besoins d’assistance particuliers. En revanche, certaines institutions considèrent la grille comme peu adaptée. Elles estiment que certains droits fondamentaux des personnes handicapées comme le libre choix de l’institution sont bafoués, par exemple lorsque des personnes requérant des soins importants n’obtiennent pas de place adaptée dans un home faute de financement suffisant. L’étude semble susciter un vif intérêt. «Tous les cantons et 40% des institutions y ont participé», se réjouit Daniela Mühlenberg-Schmitz, ajoutant: «Il y a beaucoup d’argent en jeu, 3 à 4% du budget cantonal, et il existe environ 600 institutions de ce type. C’est aussi intéressant pour le public.»
Inclure les personnes concernées dans les études
«Aujourd’hui, de nombreux travaux de recherche portent sur les personnes souffrant de handicap sans pour autant les faire participer personnellement», fait observer Daniela Mühlenberg-Schmitz, «nous voulons procéder autrement». Les personnes souffrant de handicap devraient répondre aux questions détaillées de suivi de la deuxième partie de l’étude. «Les institutions nous rapportent une certaine réduction des prestations», explique la chercheuse. «Nous voulons désormais comprendre et vérifier où et comment les personnes handicapées perçoivent cette réduction des prestations.» La deuxième phase de l’étude est elle aussi financée par des fondations. «Ce projet nous a montré l’importance du savoir-faire en matière de collecte de fonds; il faut savoir comment rédiger une demande», précise Daniel Zöbeli. «Le financement provenant de fondations est chronophage et exigeant. Nous n’avons pas encore réuni le montant total nécessaire pour la deuxième phase.» L’enseignement à tirer est qu’il est nécessaire de créer une relation de confiance avec les différentes fondations et de leur montrer l’intérêt pour la société de tels projets de recherche. Souvent, l’on aurait besoin de quelqu’un qui ouvre les portes. À l’issue de la deuxième phase, des modèles plus durables doivent être élaborés pour les institutions pour personnes handicapées. «Nous souhaitons passer de l’analyse à la recommandation et élaborer des prototypes», souligne Daniela Mühlenberg-Schmitz. «Il nous faut repartir à la recherche de financements à cette fin.» L’objectif poursuivi est de mettre à la disposition des institutions des instruments leur permettant de satisfaire à la fois aux conditions financières et à leurs propres concepts de prise en charge. «Ce n’est pas une contradiction; nous en voyons déjà quelques bons exemples pratiques.»
Pionnière de l’apprentissage à distance en parallèle à une activité professionnelle en Suisse.
«80% de l’apprentissage ont lieu à la HESD via Internet sous forme d’apprentissage mixte, et ce déjà depuis 20 ans», explique Daniel Zöbeli. Actuellement, environ 2500 personnes suivent des cursus d’études sur les différents sites. 140 employés et 400 enseignants travaillent pour la HESD. Celle-ci a été fondée en 1998, à l’époque pour permettre aux personnes vivant dans des vallées reculées de pouvoir suivre une formation initiale ou continue. La HESD est subventionnée aujourd’hui par une fondation d’utilité publique dédiée. Un pôle de recherche se consacre aux organisations à but non lucratif, l’accent étant mis sur les questions de financement, de gouvernance et de transparence. Différentes études, notamment sur les honoraires des conseillers de fondations ou sur les mandats OSBL externes, ont été publiées conjointement avec le Center for Philanthropy Studies (CEPS) de Bâle.