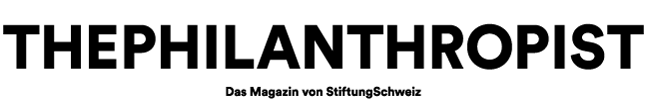The Philanthropist: Dans quelle mesure le secteur des fondations est-il numérisé en Suisse?
Georg von Schnurbein: Les fondations font partie de la société et suivent son évolution. En Suisse, nous disposons d’un énorme savoir-faire et de fondations qui soutiennent cette transition numérique, comme la Fondation Botnar. Les bases sont là. Certaines fondations sont déjà très avancées sur le sujet. Mais la plupart ne s’y sont pas encore intéressées.
La situation semble très stagnante. Vous dirigez le Centre d’études de la philanthropie en Suisse (CEPS) de l’Université de Bâle depuis sa création en 2008. Le secteur des fondations a‑t-il changé depuis lors?
Quand on y est totalement investi, on ne remarque pas le changement tout de suite. Mais bien des choses ont été faites. Je travaille avec les fondations depuis 2003 déjà. La moitié des fondations qui existent aujourd’hui ont été créées au cours de cette période. De nouvelles formes telles que la fondation faîtière ou la fondation de consommateurs ont vu le jour. En d’autres termes, notre secteur est aujourd’hui très différent de ce qu’il était il y a 15 ans. Il compte de nouveaux acteurs, de nouvelles plateformes et de nouveaux magazines.
Pourquoi y a‑t-il eu autant de créations de nouvelles fondations?
L’argent n’y est pas pour rien, évidemment. Les années fastes de la philanthropie correspondent toujours à des périodes de prospérité économique.
Et à ce moment-là que des fondations se créent?
Oui. Ce fut le cas de 1890 à 1914, comme c’est le cas actuellement depuis 1990. Nous avons comparé le nombre de nouvelles fondations avec le développement de l’indice du SMI. Leur évolution est assez parallèle. Aujourd’hui, nous assistons à un ralentissement de l’économie ainsi qu’à une baisse du nombre de nouvelles fondations.
Les finances sont donc la principale thématique?
La question de savoir comment je place mes finances est un grand défi aujourd’hui, surtout pour les petites fondations. Celles-ci ont une capacité de risque limitée. Elles ne supportent pas les pertes. Dans les médias, en revanche, on parle généralement des grandes fondations, ce qui donne l’impression que toutes les fondations ont beaucoup d’argent. Pourtant, 80 pour cent des fondations détiennent moins de trois millions de francs. Il faut garder à l’esprit que celles-ci ne fonctionnent souvent qu’avec leurs bénéfices. Si vous déduisez tous les frais administratifs, il ne reste pas beaucoup d’argent pour les projets. Mais il y a un problème plus grave: la prochaine génération de membres du Conseil de fondation. De nombreuses fondations ont vu le jour durant la période d’essor entre 1995 et 2010. Celles-ci entrent maintenant dans une phase où leurs fondateurs et leurs amis atteignent l’âge de la retraite. Il faut assurer la relève.
Combien de personnes sont nécessaires?
Il y a en Suisse environ 70 000 postes au Conseil de fondation. Environ 63 000 personnes les occupent. Cela signifie qu’une personne peut avoir plus d’un mandat au sein du Conseil de fondation mais c’est plutôt rare. Afin de remplacer les membres sortants, environ 5000 nouveaux membres sont nécessaires chaque année. Les 300 nouvelles fondations créent également 1 500 postes supplémentaires au Conseil de fondation. La recherche de volontaires dont on a besoin ici ne peut être résolu en termes monétaires.
La numérisation peut-elle aider?
Bien sûr. Rien que pour mettre en relation par exemple. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient s’investir dans le secteur mais qui ne savent pas où ni comment.
En même temps, elle peut aussi être un obstacle. Les jeunes candidats sont familiarisés avec les méthodes de travail numériques qui n’ont peut-être pas encore trouvé leur place dans les structures traditionnelles.
Le problème ne vient pas de la numérisation. Chaque génération a sa propre façon de travailler. Ces différences existaient déjà auparavant. La nouvelle génération va favoriser la numérisation.
Existe-t-il encore des fondations qui fonctionnent avec des archives papier?
Oui, il y en a encore. Mais on les voit disparaître petit à petit. Pas parce que le but de la fondation est atteint, mais parce qu’elles ne sont plus en mesure de survivre sur le plan organisationnel.
La numérisation pourrait les aider à devenir plus efficaces.
En effet. Cependant, il faut aussi noter que la gestion des fondations n’est plus la même aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Les exigences en matière de surveillance sont beaucoup plus élevées. Cela entrave l’efficacité. Les dirigeants des fondations ont donc un besoin urgent de nouvelles solutions et la numérisation n’est qu’un début de réponse. Cependant, il faut aussi considérer que les fondations ne sont pas égales face au numérique. Il y a des fondations qui sont déjà très au fait de la numérisation, surtout les plus récentes. J’en connais une qui a fermé ses bureaux et qui ne fonctionne plus qu’avec des outils en ligne.
Certaines fondations seraient-elles devenues obsolètes? D’autres formes de financement sont possibles, comme le crowdfunding par exemple.
Ces nouvelles formes de financement ne constituent pas une forme de concurrence. Ce n’est pas un problème si certaines requêtes n’atteignent plus les fondations. Au contraire. C’est bien qu’il y ait davantage d’argent disponible.
Les fondations pourraient-elles utiliser le crowdfunding?
Une fondation a déjà tenté de proposer de doubler le montant récolté si celui-ci atteignait les 15 000 francs. Dans ce cas de figure, tout le monde y gagne. Ou alors, les fondations assurent un financement de suivi d’un projet après que les donateurs ont financé son lancement. Les fondations savent se montrer flexibles. Toutefois, dans le cas des grandes fondations en particulier, le nombre de requêtes dépasse les fonds disponibles. Elles sont donc plus réticentes à s’impliquer dans d’autres processus décisionnels.
Mais les donateurs pourraient aider à élargir le choix des projets.
La démocratisation de la philanthropie est un sujet passionnant et est une éventualité à envisager. Ce qui pose toutefois problème, c’est la question de la responsabilité. Elle doit rester limitée. En fin de compte, le Conseil de fondation reste maître de toutes les décisions, que les donateurs exercent une influence ou non. C’est bien lui qui aura le dernier mot. Mais il y a des fondations qui sont déjà très ouvertes et qui, par exemple, encouragent la participation publique via des conseils consultatifs.
Mais les fondations ne devraient-elles pas, de toute façon, s’efforcer de faire preuve de transparence?
Avant de promouvoir la transparence comme une fin en soi, il convient de définir ce qu’est la norme. Exiger qu’elles soient aussi transparentes qu’une société cotée en bourse me paraît démesuré. En revanche, par rapport aux moyennes entreprises, elles ne sont pas en si mauvaise posture. Bien sûr, leur travail a un lien public en raison de son caractère non lucratif. Mais c’est également la raison pour laquelle elles sont soumises à la surveillance fédérale des fondations. La transparence est importante pour le développement du secteur, et nos recherches y contribuent.
La transparence aurait-elle au moins un effet positif sur l’image?
La légitimité et la réputation sont en effet des défis majeurs. C’est ce que nous constatons actuellement en France avec les dons importants récoltés après l’incendie de Notre-Dame. Il y a toujours eu une attitude critique à l’égard des méga donateurs. En France, il était d’ailleurs interdit jusqu’en 1983 d’établir des fondations car lorsqu’une personne possédant beaucoup d’argent influence la vie d’autres personnes, elle fait obstacle au principe d’égalité.
Et pourtant, l’objectif est de faire une bonne action?
Mais cela entraîne la fâcheuse tendance à présenter les atouts de la philanthropie de manière quasiment anecdoctique, comme si cela se résumait à «c’était un beau projet». L’ensemble des réalisations philanthropiques n’est pas encore assez visible. Je considère que la recherche doit s’y atteler. Nous devons utiliser les données et les flux financiers pour démontrer ce que le secteur fait réellement et ce qu’il réussit. Et puis, bien sûr, nous devons apprendre à parler des échecs. Les études d’impact induiront que nous ne pourrons pas tout présenter comme une réussite simplement parce que nous faisons le bien, contrairement à ce qui est d’usage aujourd’hui. Dans les rapports annuels des fondations, tout est toujours bien. Les problèmes résident dans la société. Mais il est rare qu’une fondation reconnaisse que son action n’a pas fonctionné.
Les fondations devraient-elles intervenir dans le discours social?
Comme toute autre institution, les fondations font partie de notre société. Pourquoi ne devraient-elles pas être autorisées à s’y ingérer? Jusqu’à présent, elles s’en sont plutôt abstenues. Mais aujourd’hui, elles sont plus actives. Les fondations ne veulent plus seulement fournir des fonds, elles veulent aussi prendre part au débat public. Je pense que c’est légitime.
Le professeur Georg von Schnurbein est maître de conférences en gestion des fondations et directeur du Centre d’études de la philanthropie en Suisse (CEPS) de l’Université de Bâle, qu’il a fondé et dirige depuis 2008. Le CEPS a été initié par SwissFoundations, l’Association des fondations donatrices suisses. Von Schnurbein a publié des articles sur les fondations, la gouvernance, la gestion des organismes sans but lucratif, le marketing et la philanthropie. Il a étudié la gestion d’entreprise aux universités de Bamberg, de Fribourg et de Berne, avec une spécialisation en sciences politiques. De 2011 à 2017, il a été membre du conseil d’administration du réseau European Research Networks on Philanthropy (ERNOP).