Dans un monde qui se complexifie, il devient parfois nécessaire de faire émerger de nouvelles pistes de solutions. Les fondations se positionnent avec de nouvelles formes de collaboration et des activités de financement adaptées, afin de remplir efficacement leur rôle dans la société.
«Les défis sociaux tels que le changement climatique et l’inégalité des chances doivent être abordés de concert», déclare Judith Schläpfer, directrice de la Fondation Volkart, «c’est la seule façon de développer et de mettre en œuvre des solutions efficaces». C’est pourquoi la fondation soutient de plus en plus d’initiatives qui mettent en réseau des acteurs issus de la société civile, de la science, de l’économie, de la politique et de l’administration. Dans un environnement en constante évolution, cette approche multidisciplinaire est essentielle. D’après madame Schläpfer, la collaboration dans le domaine des fondations s’est vue renforcée mais elle pourrait encore être intensifiée.

Les représentants du secteur échangent leurs points de vue dans des groupes de travail afin d’apprendre les uns des autres. Ils s’essaient à des partenariats sur des projets communs afin d’en augmenter l’efficacité. «Il va de soi que non seulement les responsables de projets réalisent leurs objectifs à travers ces partenariats, mais que nous aussi, les fondations, nous montrons ouvertes à de nouvelles formes de collaboration plus rentables», dit-elle.
Le respect d’autrui

Nora Wilhelm, co-fondatrice & initiatrice de changement de l’association collaboratio helvetica, constate également que le secteur des fondations est à la recherche de nouvelles formes de collaboration. L’objectif principal de collaboratio helvetica est justement la création de ces nouvelles formes de coopération. Nora explique: «Collaboratio helvetica est née de la prise de conscience que nous devons apprendre à travailler ensemble différemment si nous voulons répondre aux défis sociaux actuels». Selon elle, c’est la seule façon de parvenir à un changement au niveau systémique. Pour atteindre les objectifs de développement durable, il est impératif d’agir de manière ascendante.
«Nous ne pourrons concevoir un avenir durable et équitable que de manière participative. Avec une approche purement descendante, certaines sphères seront toujours désavantagées.» Pour y parvenir, il faut appréhender l’écosystème de manière globale: chacun doit connaître son rôle, comprendre celui de l’autre et le valoriser. Nora Wilhelm compare cet écosystème avec celui du corps humain: «Si moi, je suis un poumon, j’accomplis la tâche qui m’incombe et je ne dois pas chercher en même temps à accomplir celle du cœur». Cette approche peut constituer un défi car un nouvel acteur peut rapidement être perçu comme une menace plutôt que comme une ressource. «Pour qu’une telle approche s’impose, il faut un changement de paradigme, également dans les écoles et dans notre système économique», ajoute-t-elle.
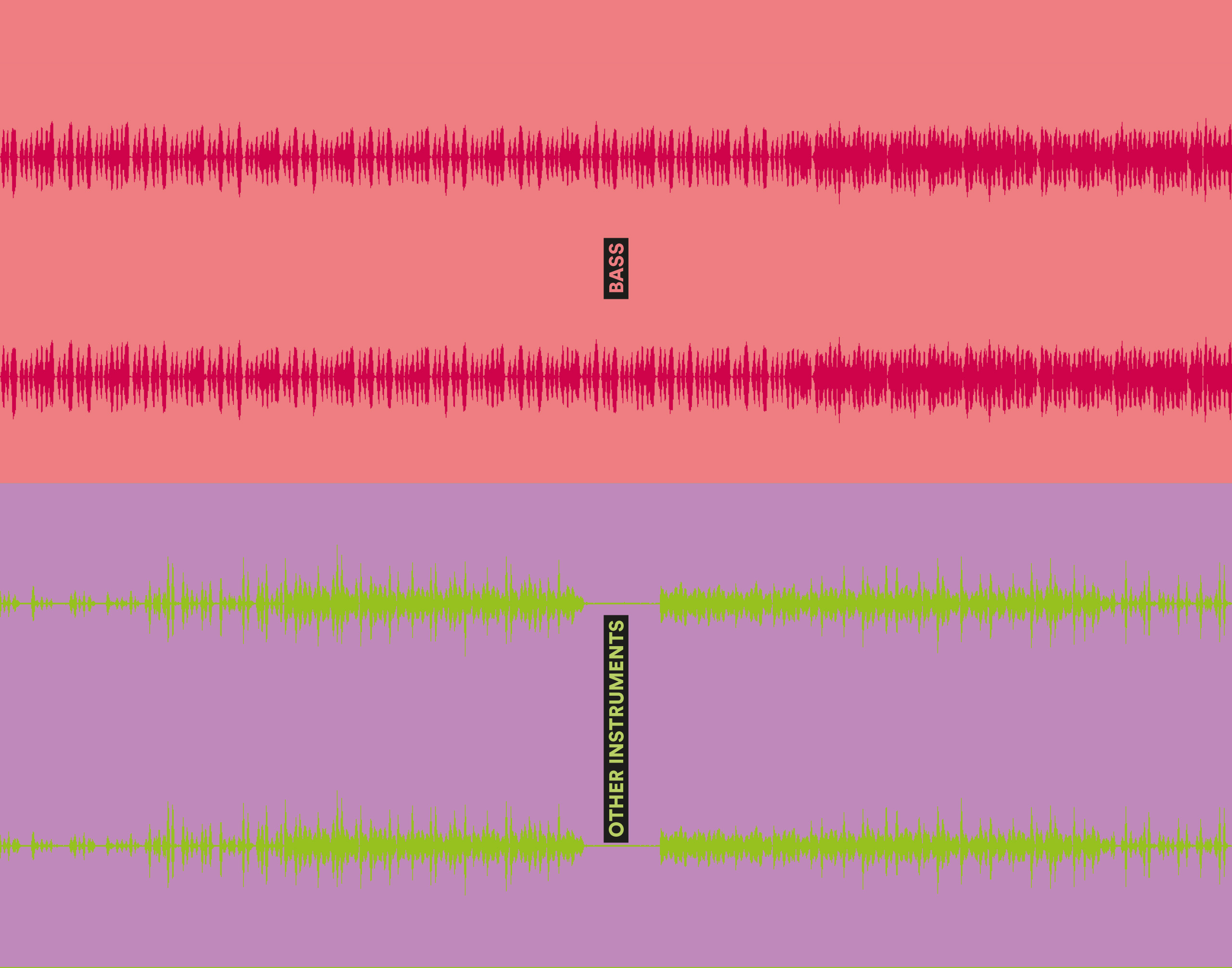
Une attribution participative des fonds
Malgré le souhait de tendre vers de nouvelles formes de collaboration, leur mise en œuvre constitue également un défi de taille pour le secteur associatif. «Les porteurs de projet savent qu’ils seront toujours en concurrence avec d’autres pour obtenir des subventions», explique Nora Wilhelm. Selon elle, cela complique énormément les échanges. Pour trouver de nouvelles approches, collaboratio helvetica a testé le concept d’attribution participative des financements. Ce sont les participants eux-mêmes qui ont dû évaluer les projets. Au cours de cet essai, certains porteurs ont mis leurs projets en commun ou ont retiré les leurs au profit d’autres. Ensemble, ils ont sélectionné les meilleurs projets à soutenir. «Mais pour mettre en œuvre cette approche dans le monde des fondations, il faut une nouvelle façon de penser», constate Nora Wilhelm, avant d’ajouter: «Cela demande de la confiance ainsi qu’un changement structurel.» Elle voit également dans cet accroissement des collaborations un grand potentiel d’amélioration pour les procédures de demandes de financement. En effet, celles-ci sont parfois très compliquées et différentes. Par conséquent, au lieu d’apprendre les uns des autres, on a plutôt tendance à se replier sur soi. À cet égard, il serait judicieux de cultiver la transparence et une meilleure culture de l’erreur. Même les échecs devraient être acceptés voire reconnus. «Dans cette optique, nous pouvons apprendre énormément les uns des autres. L’accent devrait être mis sur l’apprentissage et non sur les succès à court terme, les mesures prédéfinies et les résultats», dit-elle. «L’échec doit être possible, surtout en matière d’innovation sociale. Les expériences qui sont ouvertes au progrès nous font avancer. Mais cette démarche constitue encore un terrain inconnu pour beaucoup.»
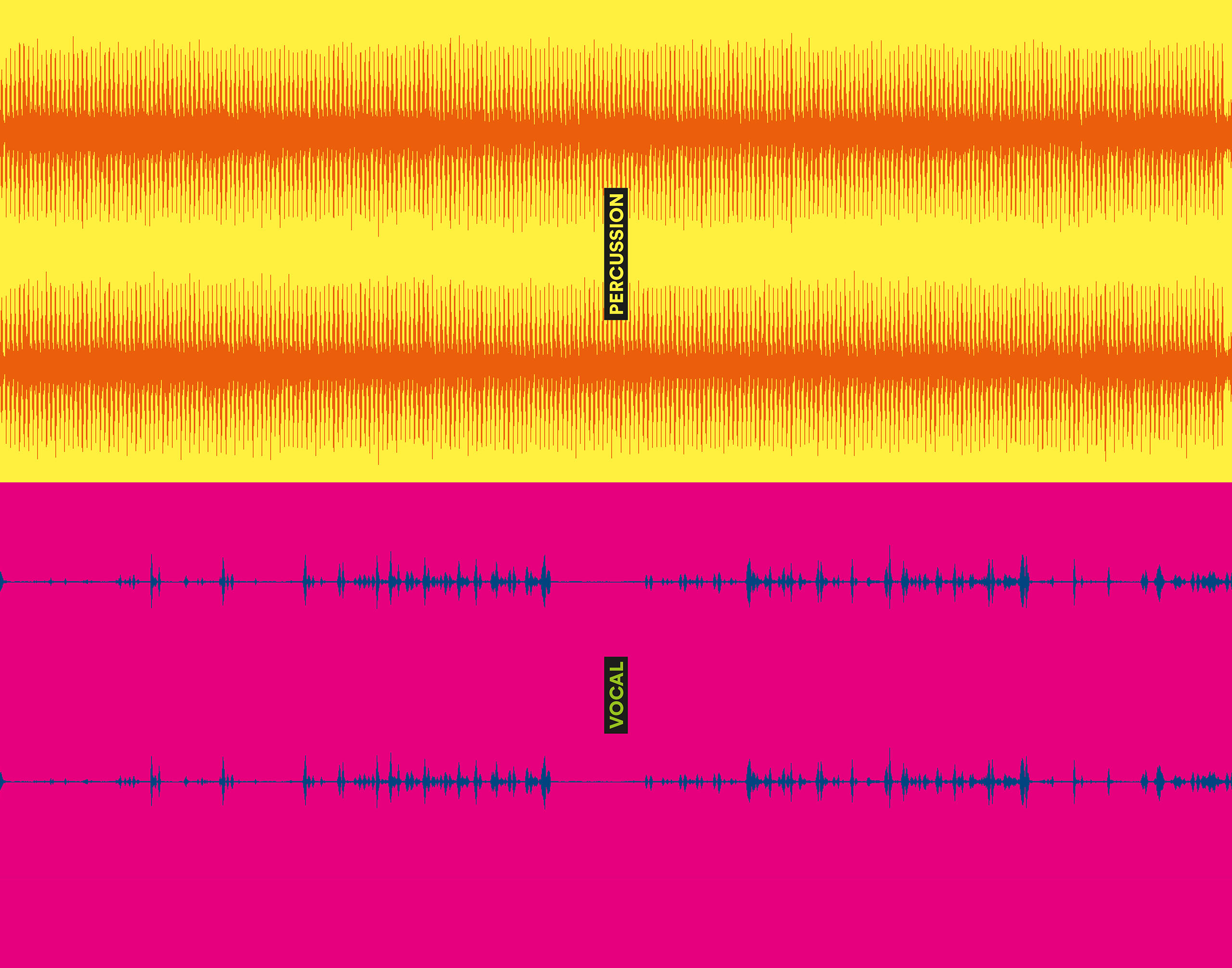
Une communication ouverte
Les fondations n’agissent pas en s’isolant du reste du monde. La notion d’utilité publique confère à leur travail une pertinence pour la société. Elles doivent donc s’en préoccuper. Pour Henry Peter, directeur du Geneva Centre for Philanthropy de l’Université de Genève, l’exigence de transparence ne se limite pas aux organisations partenaires. La société aussi a des exigences. «Les donateurs ont parfois le désir légitime de donner pour le bien commun sans pour autant se mettre en avant», rétorque-t-il, «ce qui est finalement l’expression ultime du véritable altruisme».

Alors que l’origine des fonds doit clairement être «propre», cela ne signifie pas qu’ils doivent être rendus publics. Monsieur Peter observe néanmoins une évolution vers une communication plus ouverte dans le secteur des fondations. Au vu de la situation internationale, cette évolution prend de l’importance. Alors que les besoins augmentent indéniablement, les moyens disponibles pour soutenir le bien commun augmentent également, parfois de manière exponentielle, explique Henry Peter. On sait que, surtout aux États-Unis, lorsqu’une immense richesse est créée en très peu de temps, cela conduit souvent à la création de fondations dont la fortune ou les revenus sont alors inimaginables. D’après Peter, la question de la légitimité de certains de ces nouveaux développements se pose désormais. «Ces dernières années, des voix critiques se sont élevées pour dénoncer l’intérêt personnel, l’inégalité et l’exercice non démocratique du pouvoir que suscitent certaines de ces initiatives philanthropiques», explique-t-il. «Bien que la philanthropie ne soit pas toujours parfaite, elle porte souvent des valeurs qui doivent être protégées et promues.» Cela fait partie de la recherche et de l’enseignement du Geneva Centre for Philanthropy, dont la mission est d’équiper de manière adéquate les universitaires et les praticiens afin qu’ils puissent poursuivre leurs études et relever les défis évolutifs de la philanthropie.
Nouvelles approches
En Suisse, les fondations s’adaptent elles aussi aux évolutions sociétales et aux nouvelles attentes de la population.

Peter Brey, directeur de la Fondation Leenaards – active dans les domaines «culture, âge & société et scientifique» – en est bien conscient : « Les fondations sont appelées de plus en plus à expliquer qui elles sont, la nature de leur action et leur mode de gouvernance, tout en valorisant les résultats tangibles de leurs soutiens pour l’ensemble de la société. Et d’ajouter, De plus en plus de fondations inscrivent par ailleurs leur action dans le cadre d’un dialogue ouvert avec les bénéficiaires et partenaires, et plus largement avec les citoyens ».
A l’écoute de ces mutations, la Fondation Leenaards a ainsi étendu sa stratégie. En complément à ses instruments classiques de soutien, elle a développé une nouvelle approche par le biais d’initiatives. «Dans une société où les problématiques sont toujours plus complexes, il nous paraît indispensable de compléter notre logique de soutien par projet avec une démarche plus globale stimulant une dynamique d’ensemble.» C’est notamment le cas dans le domaine des sciences. Parallèlement à son soutien traditionnel à la biomédecine, la Fondation Leenaards a lancé, en 2021, l’initiative «Santé intégrative & société» (santeintegra.ch) dont les contours ont été formulés lors d’ateliers réunissant un panel d’experts d’horizons différents. Ils sont partis d’un double constat : plus d’un tiers des Suisses ont recours à des médecines dites complémentaires et une bonne moitié des soignants sur le terrain sont des thérapeutes non conventionnels. «Cependant, il est avéré que ces deux mondes – à savoir celui des approches dites conventionnelles et complémentaires – ne se connaissent pas suffisamment, ce qui met à mal une approche intégrative du patient», explique Peter Brey. L’objectif de l’initiative vise à rassembler ces deux mondes, tout en valorisant le patient comme protagoniste de son parcours de soins. Pour soutenir cette dynamique, la Fondation finance plusieurs axes de développement : des projets de recherche-action avec des soutiens méthodologiques offerts aux porteurs de projets ; un think tank réunissant des thérapeutes de divers courants de soins et des patients ; ou encore une plateforme d’échange et d’information. Une enquête populationnelle, dont les résultats sortiront au printemps, fait également partie des vecteurs clés de l’initiative. Une méthodologie participative, impliquant patients et citoyens, a d’ailleurs été spécifiquement mise en place avec le ColLaboratoire de l’Université de Lausanne pour mener cette enquête auprès de 3000 Romands, en partenariat avec le Centre de compétences suisse en sciences sociales — FORS. Elle sera suivie par des laboratoires citoyens visant à identifier des pistes tangibles pour faire évoluer les questions de santé aux niveaux individuel et systémique.
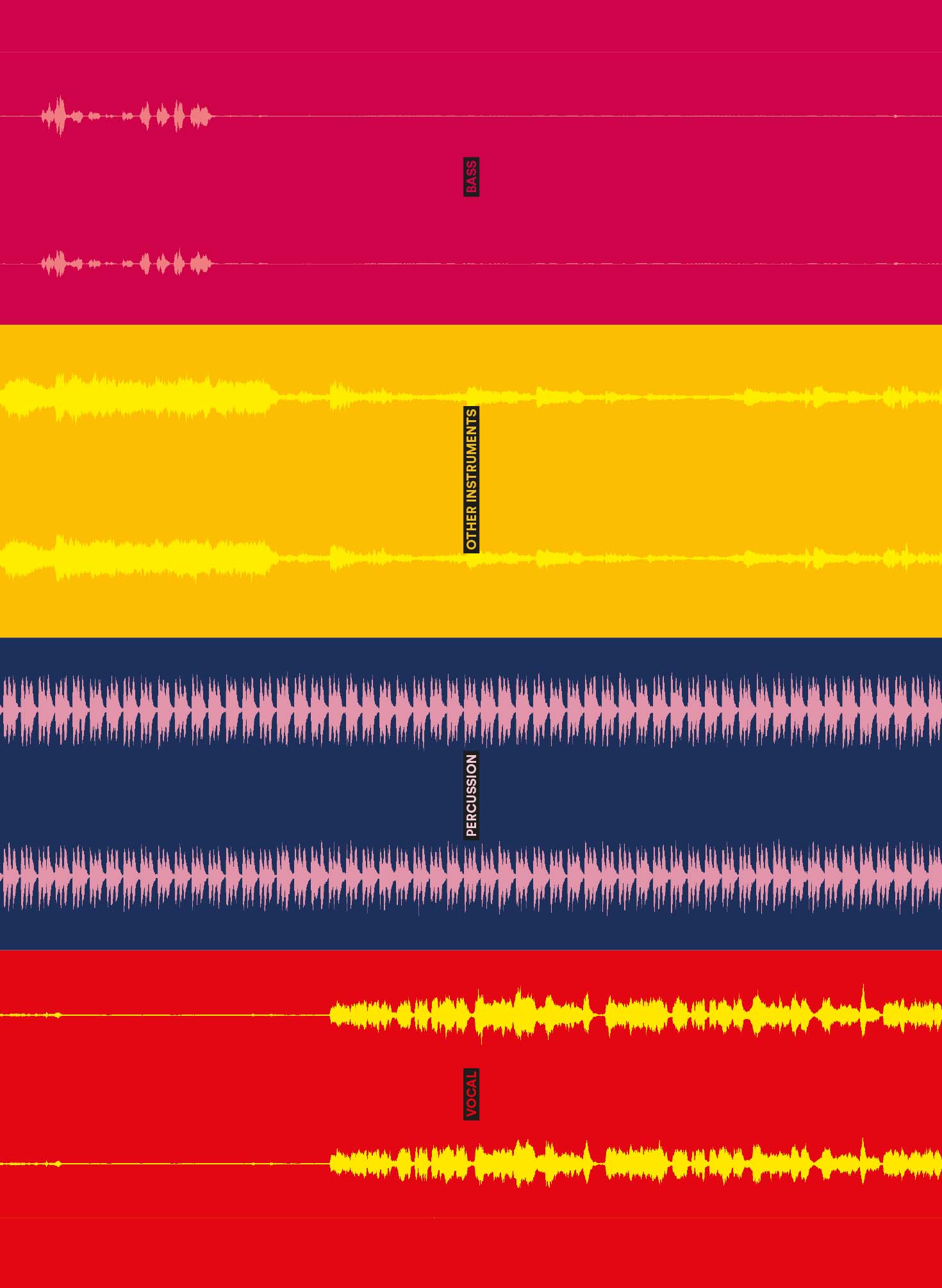
Les collaborations peuvent aller plus loin, impliquer des acteurs plus nombreux et plus divers: réunir l’État, le secteur privé, la société civile et les fondations, encourager les acteurs du changement et mieux les mettre en réseau, telle est la mission de collaboration helvetica. Pour ce faire, l’association agit de manière intersectorielle. «Mais nous ne sommes pas neutres. Nous avons des objectifs et des principes éthiques et durables pour nous guider», explique Nora Wilhelm. Mais ils ne polarisent pas, recherchent ce qui est commun et veulent unir au lieu de continuer à diviser. Si une grande banque invitait des activistes à échanger sur une thématique spécifique, cela pourrait dissuader les activistes de participer, et inversement. Collaboratio helvetica, en revanche, peut réunir les deux.
Des questions sous-jacentes
Pour Andrew Holland, directeur de la Fondation Mercator Suisse, face à l’urgence de certains sujets tels que le changement climatique et la polarisation de la société, il devient nécessaire pour les fondations de mener des actions conjointement. De nombreuses interrogations alimentent les discussions: «À quoi ressemblera la philanthropie du futur? Est-ce que chacun abordera un problème de son côté ou pourrons-nous avoir plus d’impact ensemble?»

L’activité de financement s’en trouvera modifiée. Outre les modèles de soutien collaboratifs et les approches systémiques, le passage d’une promotion ponctuelle de projets à une promotion structurelle accrue est également un thème important pour les fondations comme Mercator Suisse. Andrew Holland estime que la promotion ciblée du développement organisationnel appartient à cette dernière catégorie. «Un donateur qui soutient un projet a tout intérêt à soutenir une organisation résiliente qui travaille de manière efficace et durable», dit-il. Dans le cadre de ses financements de projets, la Fondation Mercator Suisse soutient depuis longtemps ses partenaires également dans le domaine du développement. «Cela a bien fonctionné», dit Andrew Holland, «mais nous avons réalisé qu’il fallait en outre des soutiens ciblés pour des projets de développement organisationnel purs et pour des compétences individuelles». Pour ce dernier point, la fondation a développé des offres destinées aux ONG, dont des ateliers sur l’agilité, les médias sociaux et le design thinking, qui donnent aux participants des méthodes pratiques et favorisent la mise en réseau et l’échange d’expériences. C’est justement avec des thèmes comme l’agilité et d’autres nouvelles méthodes de travail que la question se pose pour de nombreuses organisations: quelles sont les méthodes qui sont pertinentes pour moi? «Nos offres de formation continue aident également les organisations à savoir si elles souhaitent approfondir un sujet», explique Andrew Holland. Afin de renforcer les ONG de manière encore plus ciblée pour qu’elles puissent assumer leur rôle important d’actrices de la société civile, la fondation est en train de développer ses processus et ses instruments de développement organisationnel. Afin de savoir où en sont les organisations à but non lucratif dans leur développement, de quoi elles ont besoin et comment les fondations peuvent les soutenir efficacement, la Fondation Mercator Suisse prévoit de mener une enquête. Elle souhaite la concevoir et la réaliser en collaboration avec d’autres fondations donatrices intéressées.
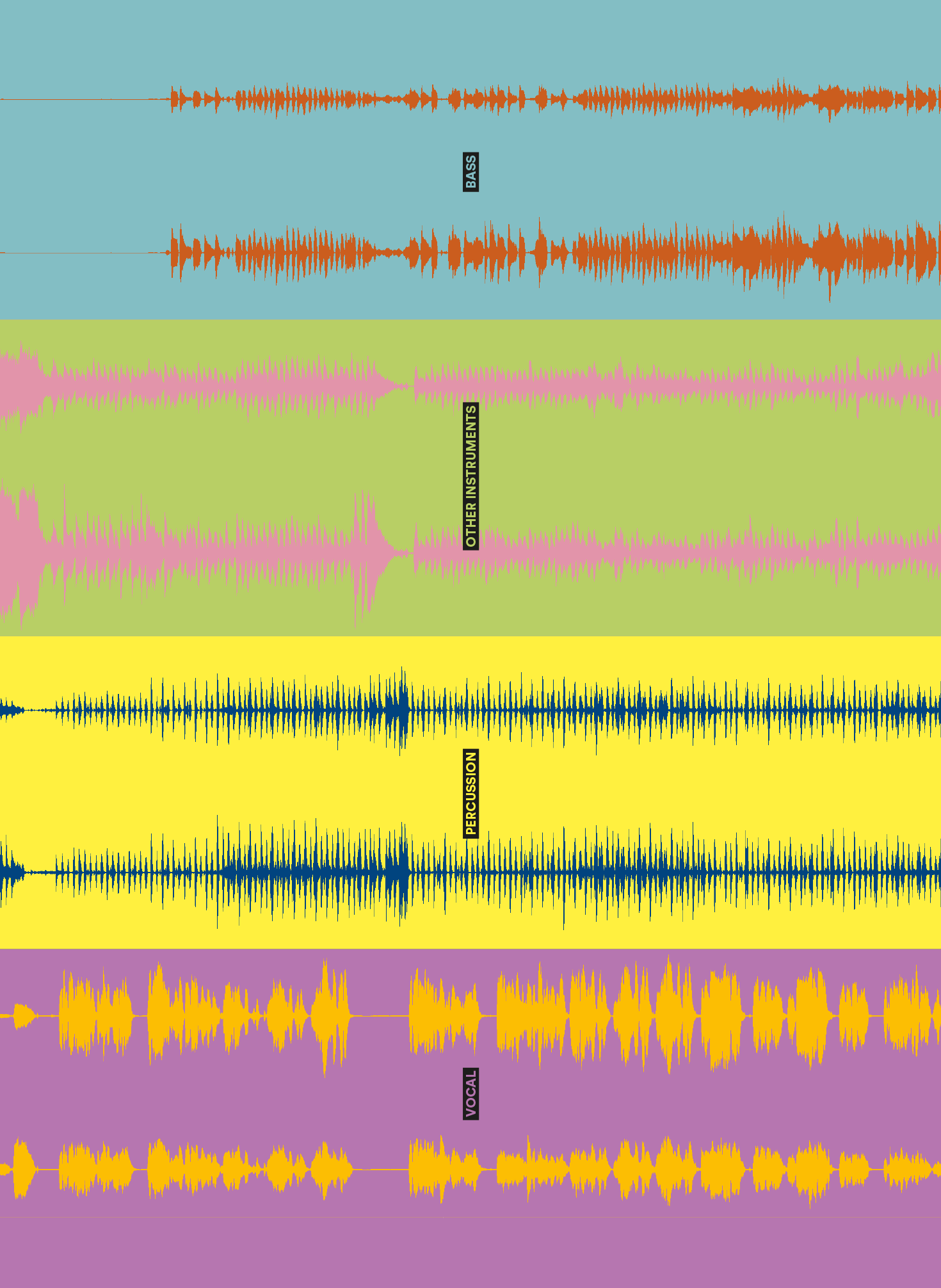
Supprimer la hiérarchie
Henry Peter sieht den Stiftungssektor gut gewappnet für die neuen Arbeitsmodelle. Stiftungen sind oft getrieben von einer wachsenden Aufmerksamkeit für Werte, die zur DNA des gemeinnützigen Sektors gehören. «Auch lässt sich wahrscheinlich sagen, dass sich die Ziele der meisten Stiftungen mit dem Konzept der Sustainable Development Goals überschneiden, nämlich nachhaltige und sozial verantwortliche Verhaltensweisen und Ziele», sagt er. Ein Vorteil erkennt er tendenziell auch bei kleinen Organisationen mit einer offenen Kultur. Sie können neue Zusammenarbeitsformen leichter schnell annehmen. Allerdings ist Struktur nicht alles. «Es sind vor allem die Menschen, die über die Fähigkeiten und die Überzeugung verfügen, dass neue Formen der Zusammenarbeit zu einer effizienteren Philanthropie beitragen können oder nicht», sagt er. Das zeigt sich im Führungsverständnis. Wo die Entscheidungsbefugnis verteilt ist, erfolgt die Zusammenarbeit effizienter und die Qualität der Leistung ist besser. «Zudem können das Wissen und Soft Skills der Mitarbeitenden besser genutzt werden als in einer hierarchischen Struktur», sagt er. Eine solche Umstellung und die Aufhebung der Hierarchien hat die Stiftung IdéeSport vor zwei Jahren angestossen. Eine agile, lernende Organisation ist das Ziel.

Les premières expériences ont été positives: «C’est une forme de collaboration qui nous convient, qui convient aux collaborateurs et qui est en même temps très exigeante pour eux», explique Sandro Antonello, développeur organisationnel chez IdéeSport. Elle a également fait ses preuves pendant la pandémie de Covid-19.
Mais Sandro Antonello fait aussi remarquer ceci: «C’est une forme de collaboration très exigeante qui comporte de nombreux défis. Seul ou en équipe, il faut pouvoir assumer des responsabilités, prendre des décisions et gérer des situations conflictuelles. Ce n’est pas toujours facile.» Mais les employés se sont mis au travail avec enthousiasme. «Ils étaient tellement motivés qu’il a fallu les freiner pour que le système ne soit pas surchargé. C’était impressionnant», se souvient-il. Le fait qu’IdéeSport soit une organisation à but non lucratif a aidé, car même une organisation agile place l’humain et le sens au centre de ses préoccupations. La raison d’être de l’institution reste l’objectif principal. Sandro Antonello poursuit: «De nombreuses entreprises rêvent d’une telle situation de départ pour lancer une transformation agile». Mais cet avantage est aussi un défi. Comme les employés accordent une grande importance à la cause de l’action, il est essentiel de partir d’une conception commune. C’est pourquoi les employés d’IdéeSport ont travaillé ensemble à l’élaboration de ces thématiques. «Mais il est aussi important que tous les collaborateurs puissent trouver leur propre raison d’être», explique Sandro Antonello. Pour lui, il est très important que les employés aient ce point de vue et qu’ils remettent régulièrement l’ensemble en question. Cette confrontation critique favorise le dialogue et la progression. «Mais bien sûr, il ne faut pas que ces raisons d’être s’éloignent trop». Il précise en outre qu’une organisation dite agile n’est pas synonyme de démocratie de base. Des responsabilités sont attribuées. «Lorsque le projet est terminé, la transformation et le développement se poursuivent», précise Sandro Antonello. Et lorsqu’il assure que certaines mesures n’ont pas fonctionné, cela a presque une consonance positive. Car cela fait partie du jeu. Un processus itératif avec des feedbacks conduit à des vérifications et à des ajustements permanents. «C’est ainsi que nous avons à nouveau supprimé certains rôles ou organes d’échange.»
Les limites
Au niveau stratégique, Mercator Suisse mise également sur un processus itératif fondé sur le suivi, l’évaluation, l’apprentissage et l’adaptation (MELA en anglais). Afin de pouvoir réagir de manière flexible et en temps réel aux évolutions de la société, la fondation a introduit des méthodes agiles. «L’agilité va au-delà de la flexibilité. Il s’agit aussi d’anticiper et d’être proactif», explique Andrew Holland. C’est pourquoi Mercator Suisse a créé un poste pour les questions d’avenir et des groupes de travail internes en vue de l’évolution de leur fonctionnement. Mercator Suisse a fait de bonnes expériences avec cette méthode de travail «hybride», une combinaison de méthodes agiles et classiques. Toutefois, ces nouveaux modèles ont aussi leurs limites. Henry Peter le souligne: la législation actuelle est conçue pour une approche hiérarchique traditionnelle et convient de moins en moins aux modèles modernes. Ainsi, la gouvernance est également mise à l’épreuve. Le défi consiste à trouver le modèle qui convient à chaque moment. L’inertie des adaptations entrave le développement. Pour Henry Peter, «une bonne gouvernance efficace reste un élément clé dans toute organisation.»
Ensemble, quand c’est judicieux
Le Fonds pionnier Migros et le Pour-cent culturel Migros poursuivent tous deux des modèles de collaboration innovants avec d’autres organismes de subvention.
Stefan Schöbi est responsable Société de la direction Société & Culture de la Fédération des coopératives Migros et dans le cadre de ses fonctions, il gère le Fonds pionnier Migros et des projets sociaux à l’échelle nationale du Pour-cent culturel Migros. Il constate: «De par notre mission, nous avons l’habitude de mener une collaboration étroite avec d’autres acteurs de la société civile.»

De nombreux projets dans le domaine de la société sont même développés et financés de manière coopérative et selon le principe de subsidiarité. Les projets sociaux à l’échelle nationale ont alors généralement au moins un autre partenaire, qu’il s’agisse d’une fondation ou d’une haute école spécialisée. Mais la collaboration ne doit pas nécessairement se faire en parallèle. Le Fonds pionnier reprend en partie des projets que d’autres ont financés au départ et les met ensuite à l’échelle dans toute la Suisse. Les partenariats de soutien fonctionnent ainsi les uns après les autres. Stefan Schöbi cite l’exemple de la Startup Academy, pour laquelle la fondation Gebert Rüf s’était d’abord fortement engagée, avant que le Fonds pionnier ne donne une plus grande ampleur au projet. Stefan Schöbi voit encore un certain potentiel: «La coordination et la compatibilité sont d’une importance capitale. Dans ces domaines, le secteur des fondations et des subventions a encore des progrès à faire.» Inversement, il cite comme projet particulièrement intéressant et inspirant le modèle de Co-Impact, une forme de philanthropie collaborative. «Il s’agit de différentes fondations qui regroupent leurs fonds et qui ouvrent en même temps leur portefeuille à d’autres co-investisseurs», explique Stefan Schöbi. «Cette pratique repose sur une focalisation thématique et régionale commune, en l’occurrence, la lutte contre la pauvreté dans le Sud, et sur des principes partagés pour la mise en œuvre, une sorte de boîte à outils méthodologiques». Ce modèle est documenté de manière transparente, c’est pourquoi il est facile d’en mettre en œuvre certains éléments. La collaboration des promoteurs rend leur travail ciblé, efficace et durable. L’approche commune déplace l’attention d’un projet individuel vers une perspective à long terme. Malgré tous les effets positifs que Stefan Schöbi voit dans les projets communs, il fait remarquer que tous les projets ne nécessitent pas un modèle collaboratif pour aboutir. «Comme le dit le dicton: tout seul on va plus vite mais ensemble, on va plus loin.» Pour lui, les modèles collaboratifs sont surtout utiles là où les projets ont prouvé leur efficacité et doivent maintenant être ancrés durablement.
Un fonds commun de financement
«Après une phase pilote réussie, il est important de mettre les projets à l’échelle afin de leur conférer une plus grande portée», explique Judith Schläpfer. «Il faut des projets pilotes dans le cadre desquels de nouvelles approches sont audacieusement testées et des partenariats non conventionnels sont noués. C’est ainsi que l’on acquiert des connaissances, que l’on comprend de manière approfondie des situations complexes et que l’on peut ainsi prendre position de manière crédible.» Afin d’obtenir une plus grande portée en matière de changements positifs, la Fondation Volkart concentre davantage ses activités de soutien sur la facilitation de changements systémiques plutôt que sur la lutte contre les symptômes par le biais de projets. Une vision à long terme et la lutte contre les causes restent également indispensables pour obtenir des changements systémiques positifs. C’est pourquoi cette fondation septuagénaire ne verse presque plus que des subventions générales d’exploitation au lieu de contributions individuelles à des projets. Cela permet aux organisations bénéficiaires d’adapter rapidement leurs activités et de saisir les opportunités avec agilité. Les principaux facteurs de réussite pour initier avec succès un changement systémique sont le travail de plaidoyer, le développement organisationnel, le renforcement des compétences et la création de partenariats. Comme projet réussi, elle cite ChagALL, un programme de subvention visant à améliorer l’égalité des chances en matière de formation à l’adolescence. Différentes fondations, dont la fondation Volkart, le soutiennent conjointement pour plusieurs années. «Le modèle de soutien a été revu de façon à ce que ChagALL puisse, grâce à l’expérience et à l’expertise acquises, soutenir de manière significative des initiatives similaires lors de leur mise en place», explique Judith Schläpfer. Un fonds financé par plusieurs fondations a été créé à cet effet, qui a également assuré le soutien financier de ces nouveaux projets. En 2021, ces programmes de soutien et les institutions qui y sont liées ont fusionné pour former l’Alliance Chance+. En collaboration avec d’autres fondations, la Fondation Volkart a accordé un financement de départ à l’association Allianz Chance+. Celle-ci associe les connaissances pratiques issues des projets de promotion aux connaissances issues de la recherche en sociologie et en sciences de l’éducation. Les recommandations d’action qui en résultent pour la pratique scolaire et les politiques d’éducation sont portées par les membres de l’Alliance auprès des milieux politiques, de l’administration et du public. Cette approche permet un changement au niveau systémique.


